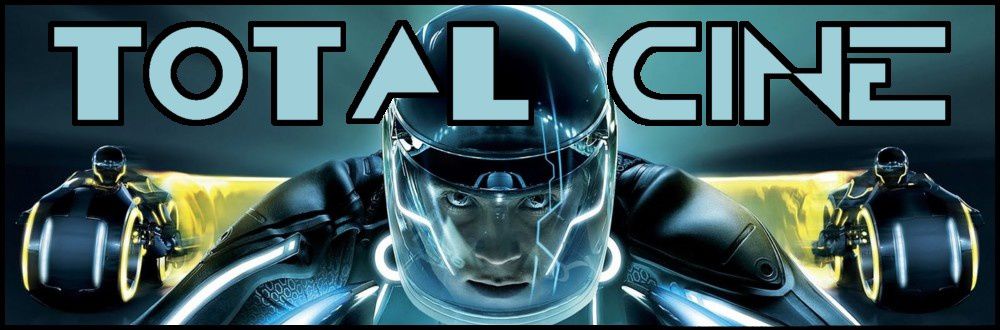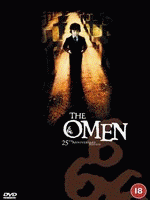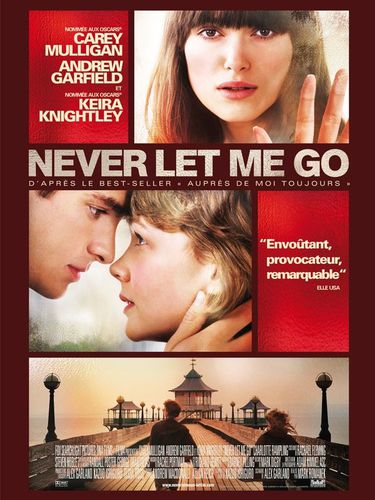Le cinéma d’aujourd’hui a vu son vocabulaire s’enrichir depuis une quinzaine d’années. Il ne se passe pas une semaine sans que les médias du monde entier parlent de remake, reboot, préquelle ou séquelle.
Des projets farfelus, des adaptations sans saveur, des annonces pour le moins douteuses polluent notre plaisir basique de cinéphile. Les plus intransigeants d’entre nous estiment qu’une partie d’une 7ème art semble courir à sa perte.
Notre patrimoine, notre histoire personnelle d’amoureux du cinéma est pavé de classiques, de références incontournables qui traversent allégrement les décennies sans subir les affres du temps et la volonté clairement affichée de producteurs en mal d’inspiration de vouloir coûte que coûte moderniser ces icônes que nous citons sans cesse dans nos conversations.
"Alien" de Ridley Scott fait partie de ces incontournables de ce patrimoine cinématographique. Un long métrage fondateur sans cesse copié mais jamais égalé selon la formulé consacrée.
Nous avons tous en mémoire des images fortes (le xénormorphe accroché au visage de Kane-John Hurt, le sang giclant sur le corps de Lambert-Veronica Cartwright), l’impression d’étouffement progressif provoqué par l’exiguïté du "Nostromo", la vision de la créature imaginée par Giger, la musique de Jerry Goldsmith et surtout la maestria de la mise en scène.
Petite aparté : le blu-ray rend vraiment grâce au film de 1979. La restauration technologique permet de redécouvrir bien des aspects de l’œuvre.
L’annonce, voilà bientôt 18 mois, de la mise en chantier d’un projet "s’inspirant" de son illustre devancier en a déconcerté plus d’un, moi le premier.
Et si Ridley Scott avait cédé comme bien aux grands argentiers du cinéma ?
Il n’est jamais bon de laisser s’emballer la machine. Nous avons eu le droit à une impressionnante collection de rumeurs, démentis, nouvelles alarmantes etc... j’en passe et des meilleurs.
Il est certain aussi que Ridley Scott lui-même a volontairement brouillé les pistes puisqu’à l’origine il n’était même pas certain qu'il soit aux commandes de ce projet insensé.
En réalité il ne faut pas grand-chose pour que la magie opère : une première photo, une affiche à l’esthétique minimaliste mais très efficace et surtout une première bande annonce coup de poing ont suffit à calmer l’ardeur des plus vindicatifs.
"Prometheus" était né.
Il ne manquait plus qu’une sortie cinéma. Car après tout, tous les discours du monde, les idées émises au préalable dans les rédactions ou dans les salons ne remplaceront JAMAIS l’intimité d’une salle obscure quand le spectateur est confronté directement à l’objet de son désir.
En une semaine j’ai vu deux fois "Prometheus" (VO-2D et VF-IMAX 3D) et je dois reconnaître que le long métrage de Ridley Scott est, veuillez m’excuser pour mon langage trivial, un "putain de film".
Un véritable coup de génie. Ridley Scott marque le terrain une nouvelle fois avec un film ambitieux et racé.
J’aurai du commencer mon article par une déclaration en forme d’évidence mais ami spectateur si tu vas au cinéma pour voir du "Alien" réchauffé à la mode du 21ème siècle, alors passe ton chemin et ne dépense pas ton argent inutilement.
Même si la filiation intellectuelle, culturelle et filmographique est évidente, intime même, "Prometheus" est bien autre chose.
Personne ne niera le fait que nous évoluons dans un univers familier. La réussite initiale de Ridley Scott est d’ouvrir la perspective dès les premiers instants du long métrage.
Au centre de l’œuvre est enracinée la problématique sur l’origine de la vie et du monde terrestre tel que nous le connaissons. Le voyage inter galactique qu’entreprennent les héros du long métrage prend l’apparence d’une quête quasi biblique sur la genèse de l’homme. L’hypothèse d’une création extra-terrestre décidée par des "Architectes" s’impose à nous avec force et beauté.
Cependant tout n’est qu’une histoire d’interprétation personnelle car la qualité de "Prometheus" est de provoquer la réflexion qui engendre elle-même l’élaboration de théories diverses et variées. La toile n’a pas fini de s’enflammer avec ces dernières.
L’immersion est totale. Le film est passionnant, osé, grandiose à de nombreuses reprises.
Les scénaristes, dont Damon Lindelof, ont su créer un ensemble cohérent et intelligent. A aucun moment la trame narrative ne cède aux sirènes de la facilité et de la gratuité.
Les événements se déroulant sur LV-223 (planète d’origine du xénomorphe dans "Alien") nous interpellaient forcément mais l’habilité du metteur en scène est de ne pas se livrer à un jeu de questions-réponses pendant deux heures. Vouloir tout expliquer aurait été suicidaire.
Ridley Scott a su osciller avec succès entre filiation et mise à distance. Son "Prometheus" gravite dans la galaxie de son prédécesseur mais conserve son indépendance, sa fraîcheur et surtout sa liberté de ton.
N’oublions pas tout de même que "Prometheus" est aussi un formidable long métrage de science-fiction. Tous les codes en vigueur sont respectés. Les univers graphiques sont d’une esthétique à couper le souffle. Les décors intérieurs ont un design qui impressionne par la pureté et la justesse des lignes. On apprécie énormément le mariage réussi entre des tonalités que tout pourrait opposer.
Les paysages (dont ceux issus du tournage en Islande) émerveillent par leur côté "extra-terrestre". La profondeur de champ est saisissante et la rudesse du climat nous explose au visage.
Plutôt que de miser sur la débauche de lieux et d’événements, Ridley Scott a préféré la cohérence d’un monde centré autour d’un étrange site archéologique qui recèle bien des secrets.
Je dis souvent qu’un long métrage est une histoire de rythme. Ridley Scott, comme souvent par le passé, a su alterner les moments intenses, intrépides, déroutants et les situations où le temps semble suspendre son vol.
Au fil des minutes la tension s’installe et surtout le doute s’insinue dans nos esprits. Le rôle de l’androïde David (l’incontournable Michael Fassbender) est plus que central. Le travail d’Elisabeth Shaw (Noomi Rapace), être à la fois empreint de rationalité scientifique et d’une certaine mystique religieuse, cimente l’ensemble. Leurs relations, interactions, échanges sont les pivots du film.
C’est l’un des canons de la galaxie Scottienne, à l’image des duos Ripley (Sigourney Weaver)-Ash(Ian Holm)dans "Alien" mais surtout Rick Deckard (Harrison Ford)-Roy Batty (Rutger Hauer) dans "Blade Runner". Le David de "Prometheus" ressemble plus, à bien des égards à un réplicant.
"Prometheus" nous tient en haleine jusqu’au bout. On ne s’y ennuie pas une seule seconde. Nous avons le droit à notre lot de poussées d’adrénaline. Nous tressautons ici ou là quand apparaissent certaines créatures.
Même si l’écueil principal était de transformer le film en une compilation didactique, je suis sorti de la salle, comme bien d’autres, un rien frustré. Si le film apporte certaines réponses (et je n’en dirai pas trop), le long métrage ne constitue qu’une première étape sur le chemin de la vérité, si vérité il y a un jour.
Je ne m’en lasse pas mais plastiquement le film est d’une beauté renversante. Les effets spéciaux sont ambitieux et maîtrisés avec une rare efficacité.
La musique de Marc Streitenfeld est réellement divine à écouter.
Même si une film comporte une galerie de personnages intéressants, dont certains sont il est vrai relativement sacrifiés au propre comme au figuré, tels que Meredith Vickers (Charlize Theron), le capitaine Janek (Idris Elba) voire même Peter Weyland (Guy Pearce), l’homme par qui tout survient, il est indéniable que le film propulse sur le devant de la scène deux comédiens d’une très grande classe.
Michael Fassbender est devenu en moins de cinq ans un acteur de premier plan à l’aise dans beaucoup de registres. Dans "Prometheus", son détachement empreint d’un certain cynisme, son expression corporelle, son visage vide d'émotions semble-t-il font merveille.
Noomi Rapace est né du néant. Je profite pour présenter ici mes plus humbles excuses à Rooney Mara qui est une comédienne de grand talent, mais Noomi Rapace restera à mes yeux à jamais comme LA Lisbeth Salander. L’actrice suédoise transforme l’essai dans "Prometheus". Son large sourire illumine l’écran. Sa passion, sa soif d’apprendre sont communicatifs.
"Prometheus" comblera tous les publics. Le film est autonome mais s’insère aussi dans un vaste univers cohérent plastiquement et idéologiquement proche. Ridley Scott n’a pas recyclé de vieux matériaux mais a enfanté un film au scénario ambitieux et à l’aspect qui ravira les jeunes générations amoureuses du tout technologique.
L’œuvre s’appuie aussi sur la performance de comédiens parfaitement choisis et à l’aise dans ce monde-là.
PS : L’IMAX 3D ne m’a pas apporté ce que j’espérais. Je suis un poil déçu.