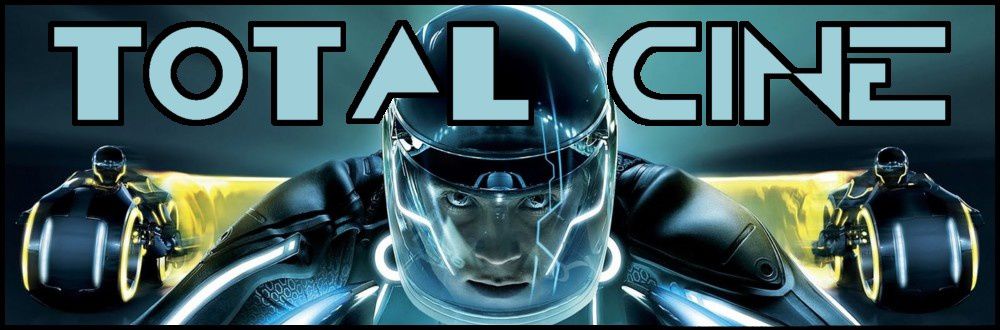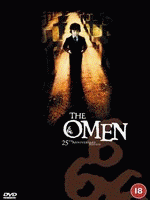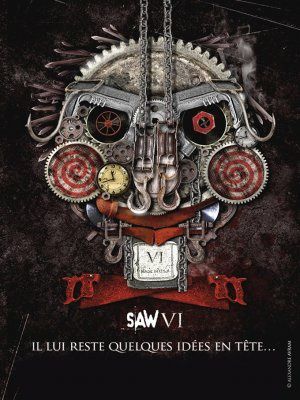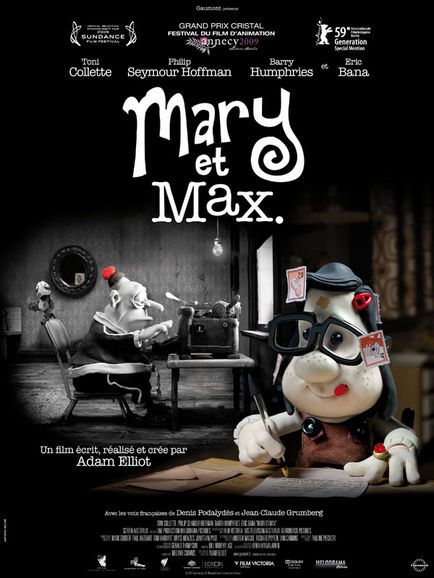Richard Kelly est un jeune cinéaste qui n’en finit plus d’étonner son monde. Après avoir subjugué la critique et le public il y a huit ans avec "Donnie Darko", long métrage magique, iconoclaste mais surtout inclassable au possible, le bonhomme a presque faillit retomber dans un oubli, tout hexagonale il est vrai, avec son "Southand Tales" qui n’a pas eu le privilège d’être distribué en salles dans notre beau pays de cinéma !!!
Mais c’était reculer pour mieux sauter. Le cinéaste américain nous revient avec un troisième long métrage de poids (il en a mis en scène 5 en tout) intitulé "The Box". Une œuvre coup de poing qui nous glace le sang. Un véritable tour de force.
Nous sommes dans l’Amérique des années 70. Arthur Lewis (James Marsden) et son épouse Norma (Cameron Diaz) mènent une vie de citoyens on ne peut plus moyens et exemplaires. Arthur est technicien à la NASA et rêve de devenir astronaute. Norma est une épouse comblée, une mère attentionnée, qui s’épanouie dans son travail mais qui souffre d’un sérieux handicap au pied.
Un matin une mystérieuse boîte, munie d’un bouton poussoir rouge, est déposée devant chez eux. Le soir même, l’énigmatique Monsieur Arlington (Frank Langella) au faciès mutilé leur indique que si l’un des membres du couple appuie sur le bouton, deux conséquences en résulteront : une personne qu’ils ne connaissent pas trouvera une mort certaine et ils recevront un million de dollars net d’impôts.
Après avoir longuement hésité Norma enclenche un processus (fatal)…
"The Box" fait partie d’une catégorie de longs métrages bien particuliers qui nécessitent un postulat de départ assez draconien : soit on adhère pleinement sans retenue et alors le spectateur s’immerge avec bonheur dans un univers si particulier, soit on se sent réfractaire et on reste sur le bord de la route (j'aime bien cette image, je l'utilise souvent)
"The Box" est de ces œuvres qui n’acceptent pas de compromis. Je me suis jeté à corps perdu dans ce film si dérangeant.
Le film est adapté d’une nouvelle de l'écrivain Richard Matheson qui a nous régalé par le passé avec entre autres "Je suis une légende" et "L’homme qui rétrécit".
Le scénario est brillant, d’une finesse et d’une précision incroyables. L’histoire nous prend aux tripes dés les premières minutes. Cette chronique prend l’apparence du destin extraordinaire d’un couple très ordinaire.
Puis nous basculons progressivement d’une situation ultra conventionnelle à un monde où le rêve et la réalité se mélangent pour nous faire perdre nos repères et nos impressions de confort rassurant. Nous plongeons au cœur d’un récit où la science fiction n’a pas besoin de mille artifices pour se montrer convaincante.
L’éternelle avidité de l’Homme est pointée du doigt sans détour. L’argent finit par détruire un couple de la plus terrible des façons. Le gain prend le pas sur les valeurs qui cimentent ordinairement une famille. L’intérêt force à faire des choix. Aux dires de Monsieur Arlington "la plus belle victoire est de ne pas appuyer sur le bouton" (citation dans l’esprit du texte même si les mots exacts me manquent).
Ce couple d’américains est pris à son propre piège d’un jeu cruel qui le dépasse. Le spectateur est témoin d'une longue descente aux enfers vers une issue qui se révèle inéluctable tant Richard Kelly distille ici ou là des éléments qui abondent en ce sens. Comme les autres j’ai ressenti le malaise grandissent subi par cet homme et cette femme.
La tension monte crescendo. Richard Kelly prend le temps de présenter ses personnages, de mettre en place l’intrigue principale et ses ramifications. Visiblement le cinéaste a eu les coudées franches pour faire son film et pas un ersatz au rabais. Durant deux bonnes heures, qui passent très vite, trop, le réalisateur a toute latitude pour nous mettre à l'aise et à l'épreuve.
Richard Kelly ne nous donne pas d’explications didactiques sur le comportement de Monsieur Arlington et de ses "employés". Il pointe du doigt certains éléments mais nous laisse volontairement dans l’ombre pour pas mal de choses. Son jeu de pistes est subtil mais diablement énervant. Le spectateur a l’impression d’évoluer dans le néant quand il passe de moments convenus à des situations non conventionnelles.
Le film peut se targuer d'être tout simplement superbe sur le plan plastique. Les images sont soignées. Les cadrages et les éclairages soulignent l’excellence de l’œuvre. Les couleurs employées sont comme des résonances de l’âme humaine tourmentée.
Les effets spéciaux sont utilisés avec une réelle mesure. Les ajouts numériques rendent service à l’œuvre sans perdre de leur force intrinsèque.
James Marsden éclate à l’écran. Son interprétation est d’une justesse inouïe. Mais la vraie révélation est Cameron Diaz. Son rôle dans "The Box" est un peu celui de la maturité d’actrice. Elle prouve ici qu’elle peut faire autre chose que des comédies basiques, que j’apprécie énormément au demeurant. Sa prestation de mère éplorée éclate dans un final aussi cruel que fort.
L’un des points forts du film réside dans le fait que la symbiose est parfaite entre les deux têtes d’affiche. L’alchimie fonctionne à merveille. L’avant dernière séquence de "The Box" utilise à fond la carte de cet amour dramatiquement conclu.
Je n’oublie pas aussi la singulière prestation d’un Frank Langella, charismatique à souhait. L’acteur impose son immense stature et donne du corps à ce personnage si mystérieux et si attirant à la fois. Pour celles et ceux qui ont la mémoire courte, je leur rappelle que l’acteur américain a incarné l’un des plus crédibles Dracula de l’histoire dans la version réalisée en 1979 par John Badham.
Richard Kelly peut légitimement prétendre au titre de "Roi de la science fiction" avec son film "The Box" tant son œuvre surprend les cinéphiles. Le spectateur a l’impression de se trouver face à un long métrage qu’il ne reverra pas de sitôt tant la science fiction semble aseptisée. L’un des tours de force de Richard Kelly est de nous entraîner dans son sillage avec un film original, débarrassé de contraintes pesantes et qui surtout se conclut avec une véritable fin.
C’est si rare.